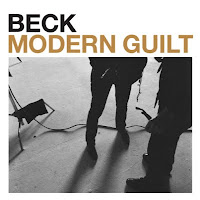...
C’est un fait : les génies doivent mourir jeunes.
Vieillir, c’est nul. C’est moche, et quand vous êtes un génie ça ne sert pas à grand-chose. Surtout quand vous êtes un génie de la musique pop : vous devez d’abord connaître une interminable traversée du désert pour seulement ressusciter l’année de vos cinquante ans avec un album produit par quelque jeune pousse en forme du moment – un calvaire pour tout génie qui se respecte. Après quoi il existe différentes manières de bien vieillir, selon la densité discographique et le caractère (difficile – vous êtes un génie) de l’individu. Vous pouvez décider au choix de vieillir avec classe (école Bowie), de vieillir avec dignité (école McCartney), de vieillir en vivant de vos rentes (école Alice Cooper), de vieillir dans le cuir (école Jagger)… beaucoup de possibilités s’offriront à vous passés vos cinquante ans, autant vous y préparer à l’avance – chacun sait que Bon vivant rime avec prévoyant. L’essentiel est que vous gardiez bien en tête cette donnée primordiale : aucun minimum vieillesse pour génies ne pourra se substituer à une belle mort tragique à l’âge du Christ.
Mais voici que s’approche le petit Beck Hansen, qui fêtait son anniversaire le mois dernier en publiant un nouvel album au titre enjôleur : Modern Guilt. Beck (pour les intimes), qui vient d’avoir trente-huit ans. Qui semble en avoir cent, tant il a publié d’albums, tant il paraît incrusté dans le paysage musical depuis longtemps. Beck, pas encore quadra et déjà dinosaure ; un génie, oui Monsieur, oui Madame – même si on l’a un peu oublié ces derniers temps. Disons : un génie à l’ancienneté. Un génie par convention, décoré par nos soins pour services rendus à la musique pop. Un génie dont le nom, désormais, résonne comme le boulet traîné par le proverbial fantôme des années quatre-vingt-dix. Car ce génie-là, comme tant d’autres, aurait plutôt tendance à jouer petit bras depuis le début de cette décennie deux-mille qui, décidément, semble destinée à être aux héros des années quatre-vingt-dix ce que fut la décennie quatre-vingt pour la plupart de leurs glorieux ainés…
Beck, donc. Certains continuent d’attendre chacun de ses albums avec une ferveur touchante. Nous aussi. A cause de son génie ? Non : à cause de son passé. Ça n’est pas condamnable – on en trouverait sans doute pour espérer secrètement depuis quarante ans que Dylan refasse un jour Highway 61. On a tous droit au rêve (au fantasme, même). Mais le fait est que Dylan ne refera évidemment jamais Highway 61, pas plus que Beck ne refera One Foot in the Grave ou Odelay. Il ne refera sans doute même pas, jamais, ni Mutations (son album de mariage de 1998) ni Sea Change (son album de divorce de 2002). Beck l’hyper-prolifique, onze albums en quinze années de carrière (dont sept entre 1993 et 1999), des hymnes à en pleuvoir ("Loser", "Devil’s Haircut", "The New Pollution", "Rowboat") et des idées plein la tête… Beck a fait pire que vieillir (en admettant qu’il y ait quelque chose de pire que ça) : il est devenu un artiste comme les autres. Publie un album d’une dizaine de chansons tous les deux ans, fait des tournées, donne des interviews. On se souvient d’un blondinet adulescent scandant sa provocante devise, « Expect the unexpected » – on n’est plus trop sûr qu’il s’agit du même. A bien y regarder on note quelques ressemblances physiques, mais on cherche en vain la folie, la singularité qui nous fit tomber en amour dès les premières notes du single Loser (1993) et qui manque cruellement à ce nouveau Modern Guilt. Un bon album « à chansons », sympathique, chaleureux et bien fichu. Comme toujours depuis 2005 et Guero, ultime sursaut de delirium du garçon qui, rétrospectivement, semblait déjà un peu forcé – comme si Beck avait essayé d’être délirant quand autrefois il était juste barge.
D’aucuns diront que Modern Guilt ne ressemble justement pas à Guero, pas plus qu’à The Information (il y a deux ans). Que c’est justement pour ça qu’il est bon, qu’il est meilleur, qu’il est plus abouti, qu’il est plus ceci ou moins cela. C’est vrai et c’est faux ; c’est difficile à contester tout en omettant de s’arrêter sur ce qui réunit ces trois albums du Beck « adulte » : le son cotonneux et le répertoire, à la fois tout à fait mélodieux et assez peu mélodique. En décrypté : les écoutes sont plaisantes, et même très agréables parfois… mais combien de morceaux accrochent vraiment et combien resteront dans les annales ? On misera sur deux : "Modern Guilt" et "Youthless" le bien nommé. Deux grandes chansons n’évoquant rien d’autre que le grand Beck, des cyber-blues aux rythmiques entêtantes et aux mélodies imparables. Le reste ? De l’excellente musique de fond résistant difficilement aux vingt écoutes d’avant rédaction de l’article. "Replica" évoque l’album solo de Thom Yorke, "Soul of a Man" la joue funk (f)rigide à la Midnite Vultures. A l’instar de l’inagural "Orphans", "Profanity Prayers" masque son manque de fraîcheur derrière des arrangements plutôt futés – encore une autre constante dans la carrière récente de Beck. Comme si le travail comme toujours exceptionnel sur le son pouvait compenser l’inanité de certaines compositions, uniquement mémorisables parce que déjà entendues cent fois ailleurs.
Le plus triste étant qu’il en va de même pour Modern Guilt que pour Guero ou The Information : les premières écoutes sont assez réjouissantes, l’ensemble est de bonne facture et le tout tient relativement bien la route. Ce qui manque ici, c’est le supplément d’âme, ce petit quelque chose qui fait qu’un album s’installe – ou non – dans la durée. Rédigé il y a un mois, cet article aurait sans doute été tout à fait positif. Tout comme les articles parus il y a deux ans sur The Information, ou il y a trois ans sur Guero – qui tous ou presque saluaient à chaque fois le retour gagnant du grand Beck. Résultat des courses : qui écoute encore The Information aujourd’hui, franchement ? A deux ou trois titres près on peut prédire le même non-avenir à Modern Guilt. Un album aussi touchant qu’anecdotique, séduisant parce que sans prétention et charmant parce que totalement prévisible. Allons, courage : plus que douze ans.
C’est un fait : les génies doivent mourir jeunes.
Vieillir, c’est nul. C’est moche, et quand vous êtes un génie ça ne sert pas à grand-chose. Surtout quand vous êtes un génie de la musique pop : vous devez d’abord connaître une interminable traversée du désert pour seulement ressusciter l’année de vos cinquante ans avec un album produit par quelque jeune pousse en forme du moment – un calvaire pour tout génie qui se respecte. Après quoi il existe différentes manières de bien vieillir, selon la densité discographique et le caractère (difficile – vous êtes un génie) de l’individu. Vous pouvez décider au choix de vieillir avec classe (école Bowie), de vieillir avec dignité (école McCartney), de vieillir en vivant de vos rentes (école Alice Cooper), de vieillir dans le cuir (école Jagger)… beaucoup de possibilités s’offriront à vous passés vos cinquante ans, autant vous y préparer à l’avance – chacun sait que Bon vivant rime avec prévoyant. L’essentiel est que vous gardiez bien en tête cette donnée primordiale : aucun minimum vieillesse pour génies ne pourra se substituer à une belle mort tragique à l’âge du Christ.
Mais voici que s’approche le petit Beck Hansen, qui fêtait son anniversaire le mois dernier en publiant un nouvel album au titre enjôleur : Modern Guilt. Beck (pour les intimes), qui vient d’avoir trente-huit ans. Qui semble en avoir cent, tant il a publié d’albums, tant il paraît incrusté dans le paysage musical depuis longtemps. Beck, pas encore quadra et déjà dinosaure ; un génie, oui Monsieur, oui Madame – même si on l’a un peu oublié ces derniers temps. Disons : un génie à l’ancienneté. Un génie par convention, décoré par nos soins pour services rendus à la musique pop. Un génie dont le nom, désormais, résonne comme le boulet traîné par le proverbial fantôme des années quatre-vingt-dix. Car ce génie-là, comme tant d’autres, aurait plutôt tendance à jouer petit bras depuis le début de cette décennie deux-mille qui, décidément, semble destinée à être aux héros des années quatre-vingt-dix ce que fut la décennie quatre-vingt pour la plupart de leurs glorieux ainés…
Beck, donc. Certains continuent d’attendre chacun de ses albums avec une ferveur touchante. Nous aussi. A cause de son génie ? Non : à cause de son passé. Ça n’est pas condamnable – on en trouverait sans doute pour espérer secrètement depuis quarante ans que Dylan refasse un jour Highway 61. On a tous droit au rêve (au fantasme, même). Mais le fait est que Dylan ne refera évidemment jamais Highway 61, pas plus que Beck ne refera One Foot in the Grave ou Odelay. Il ne refera sans doute même pas, jamais, ni Mutations (son album de mariage de 1998) ni Sea Change (son album de divorce de 2002). Beck l’hyper-prolifique, onze albums en quinze années de carrière (dont sept entre 1993 et 1999), des hymnes à en pleuvoir ("Loser", "Devil’s Haircut", "The New Pollution", "Rowboat") et des idées plein la tête… Beck a fait pire que vieillir (en admettant qu’il y ait quelque chose de pire que ça) : il est devenu un artiste comme les autres. Publie un album d’une dizaine de chansons tous les deux ans, fait des tournées, donne des interviews. On se souvient d’un blondinet adulescent scandant sa provocante devise, « Expect the unexpected » – on n’est plus trop sûr qu’il s’agit du même. A bien y regarder on note quelques ressemblances physiques, mais on cherche en vain la folie, la singularité qui nous fit tomber en amour dès les premières notes du single Loser (1993) et qui manque cruellement à ce nouveau Modern Guilt. Un bon album « à chansons », sympathique, chaleureux et bien fichu. Comme toujours depuis 2005 et Guero, ultime sursaut de delirium du garçon qui, rétrospectivement, semblait déjà un peu forcé – comme si Beck avait essayé d’être délirant quand autrefois il était juste barge.
D’aucuns diront que Modern Guilt ne ressemble justement pas à Guero, pas plus qu’à The Information (il y a deux ans). Que c’est justement pour ça qu’il est bon, qu’il est meilleur, qu’il est plus abouti, qu’il est plus ceci ou moins cela. C’est vrai et c’est faux ; c’est difficile à contester tout en omettant de s’arrêter sur ce qui réunit ces trois albums du Beck « adulte » : le son cotonneux et le répertoire, à la fois tout à fait mélodieux et assez peu mélodique. En décrypté : les écoutes sont plaisantes, et même très agréables parfois… mais combien de morceaux accrochent vraiment et combien resteront dans les annales ? On misera sur deux : "Modern Guilt" et "Youthless" le bien nommé. Deux grandes chansons n’évoquant rien d’autre que le grand Beck, des cyber-blues aux rythmiques entêtantes et aux mélodies imparables. Le reste ? De l’excellente musique de fond résistant difficilement aux vingt écoutes d’avant rédaction de l’article. "Replica" évoque l’album solo de Thom Yorke, "Soul of a Man" la joue funk (f)rigide à la Midnite Vultures. A l’instar de l’inagural "Orphans", "Profanity Prayers" masque son manque de fraîcheur derrière des arrangements plutôt futés – encore une autre constante dans la carrière récente de Beck. Comme si le travail comme toujours exceptionnel sur le son pouvait compenser l’inanité de certaines compositions, uniquement mémorisables parce que déjà entendues cent fois ailleurs.
Le plus triste étant qu’il en va de même pour Modern Guilt que pour Guero ou The Information : les premières écoutes sont assez réjouissantes, l’ensemble est de bonne facture et le tout tient relativement bien la route. Ce qui manque ici, c’est le supplément d’âme, ce petit quelque chose qui fait qu’un album s’installe – ou non – dans la durée. Rédigé il y a un mois, cet article aurait sans doute été tout à fait positif. Tout comme les articles parus il y a deux ans sur The Information, ou il y a trois ans sur Guero – qui tous ou presque saluaient à chaque fois le retour gagnant du grand Beck. Résultat des courses : qui écoute encore The Information aujourd’hui, franchement ? A deux ou trois titres près on peut prédire le même non-avenir à Modern Guilt. Un album aussi touchant qu’anecdotique, séduisant parce que sans prétention et charmant parce que totalement prévisible. Allons, courage : plus que douze ans.
✋ Modern Guilt
Beck | Interscope, 2008